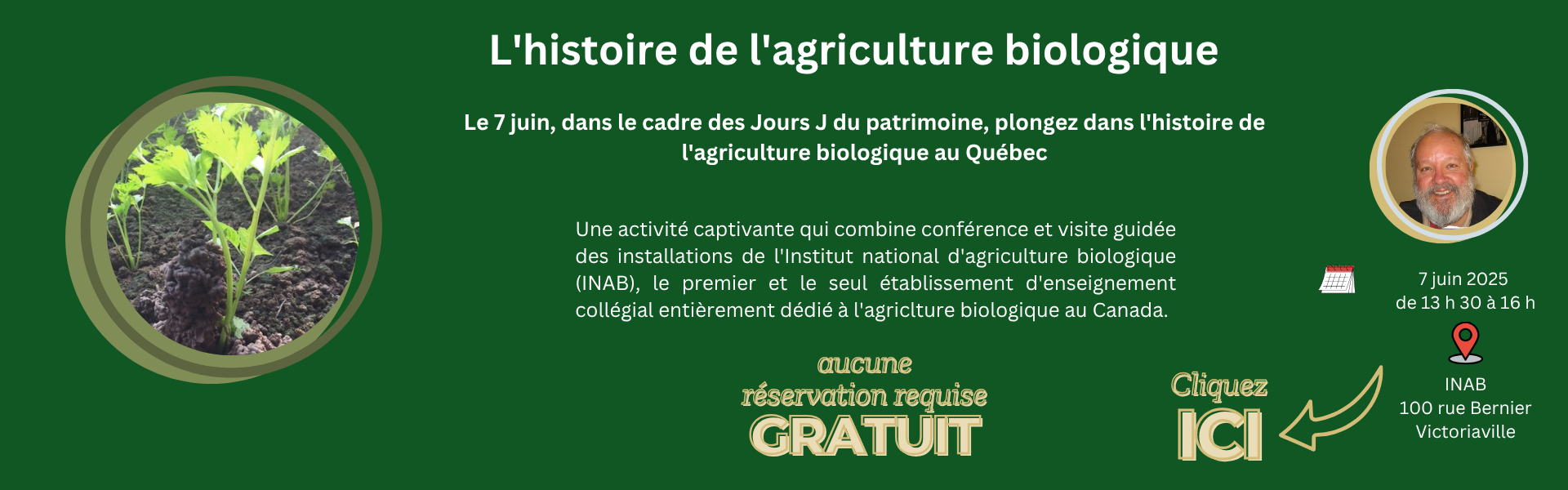
(Le véganisme n’a pas le monopole du dogmatisme)
Il est de bon ton ces temps-ci de pourfendre le véganisme en l’associant à une vulgaire religion. J’offre ici quelques réflexions remettant en perspective les arguments avancés par Jean-François Patenaude dans sa lettre du 23 janvier « Les limites du dogme végane » qui est malheureusement devenue virale.
Argument #1 : l’élevage serait bon pour l’environnement parce que les cultures fourragères ont des bénéfices environnementaux.
Détail crucial : les porcs et les poules sont nourris de grains, pas de plantes fourragères; les vaches laitières sont alimentées de grains à raison de plus ou moins la moitié de leur alimentation; et les bœufs sont engraissés principalement aux grains. La production animale génère la plus grande partie de la demande de la filière industrielle des grandes cultures. Les bénéfices écologiques des plantes fourragères viennent seulement mitiger légèrement l’impact environnemental des cultures… dont la production animale est la principale responsable. Certes, les plantes fourragères sont pertinentes dans une rotation, mais de là à prétendre que la production animale a des bénéfices environnementaux en soi, il y a une marge. L’élevage de ruminants réalisé entièrement à l’herbe peut être écologiquement intéressant (et encore, avec un bilan émetteur de GES net), mais est pratiquement inexistant sur le marché.
Argument #2 : les terribles conditions de vie des animaux à l’état naturel. On a là un jugement basé sur la transposition de préoccupations d’humain domestiqué à celles d’un animal sauvage. L’évolution a pris des millions d’années pour créer des animaux dont l’instinct et l’intelligence sont adaptés à l’environnement naturel. Il est bien présomptueux de penser qu’on leur offre de meilleures conditions d’existence en les réduisant à une vie d’esclave d’intérieur dont le moindre paramètre est réglé au quart de tour, et qui prendra fin dès l’atteinte de son poids optimal.
Argument #3 : L’estomac humain, bien qu’omnivore, ne digérerait pas les aliments végétaux efficacement.
Les autorités de santé publique préconisent pourtant un régime basé majoritairement d’aliments végétaux (légumes et grains entiers), et que le seul groupe alimentaire comprenant des produits animaux comprend aussi des substituts végétaux. Je n’ai trouvé aucune littérature scientifique supportant l’inefficacité de l’estomac humain à digérer les aliments végétaux. En revanche, on trouve différentes études et revues de littérature évoquant la supériorité d’une diète végétarienne sur la santé digestive en général (rien sur l’estomac spécifiquement). Par ailleurs, considérant que notre système agroalimentaire industriel dans un contexte capitaliste est bien loin de résulter en une alimentation optimale de la population. Le capitalisme agroalimentaire serait-il aussi un dogme crétinisant selon la grille d’analyse de M. Patenaude?
Argument #4 : l’alimentation végane est seulement possible moyennant l’importation massive de denrées pouvant couvrir ses besoins en acides aminés et vitamines.
Or, il se trouve que les besoins en acides aminés essentiels pour l’humain sont comblés par la consommation de légumineuses et de céréales, des aliments produits en abondance au Canada. La vitamine B12 est la seule difficile à obtenir avec un régime végétalien et est facilement suppléée. Une alimentation végétalienne n’est aucunement dépendante d’importation massive pour être viable. Par ailleurs, il serait plutôt hypocrite, à une époque où nos celliers et nos étales de fruits et légumes regorgent de produits étrangers dont peu de gens se privent, de condamner une frange spécifique de la population qui se permet comme les autres d’aller piger à l’étranger pour ajouter du plaisir à son alimentation.
Quand on a comme but de « dénoncer le dogmatisme crétinisant qui semble affliger le mouvement végane », encore faudrait-il apporter quelques arguments appuyant sa thèse – que le véganisme serait un dogme – au lieu de répéter quelques lieux communs complaisants en faveur de la production animale. Les bénéfices économiques et gastronomiques de la production animale ne justifient pas l’attitude de mépris ostentatoire qu’affiche un nombre croissant d’omnivores belliqueux envers des gens qui refusent simplement de supporter l’industrie.
Et même si vous ne trouvez pas ça si pire que ça, l’exploitation animale, ça ne légitimise pas votre attitude condescendante envers tout un groupe de la population, qui non seulement ont le mérite de faire des sacrifices personnels pour des raisons éthiques, mais aussi n’achalent personne avec leurs choix alimentaires pour la très grande majorité d’entre eux… contrairement à dertains omnivores qui, si je me fie à ce que je vois passer dans les médias, traditionnels et sociaux, sont de plus en plus nombreux à prendre un malin plaisir à mépriser ceux qui font des choix différents d’eux.
Cette lettre n’a pas le but de défendre le véganisme et ses pratiques, mais plutôt de dénoncer les critiques de mauvaise foi contre le véganisme par des omnivores hypersensibles à la remise en question de leurs choix alimentaires et profondément biaisés envers la défense de ces choix.
Commentaires