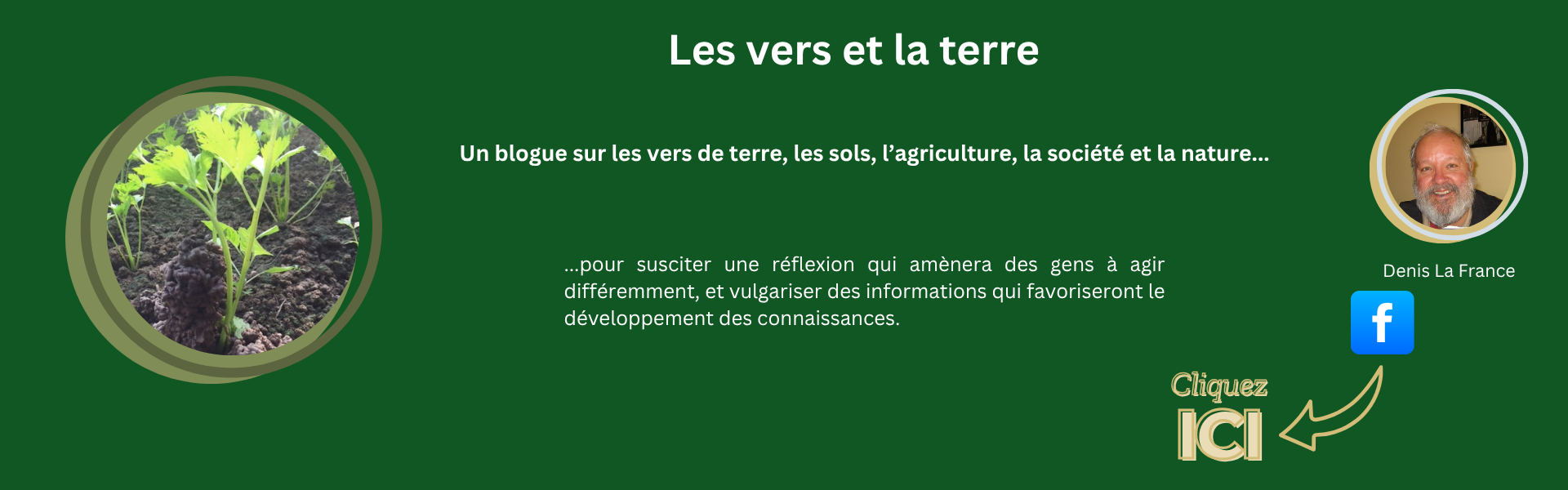
Mémoire remis à la Consultation publique sur le secteur bioalimentaire au Québec
Par un collectif d’auteurs initié par Geoffroy Ménard, agroéconomiste
À bout de recours et de patience, les agriculteur·trices ont pris la rue ce printemps pour réclamer davantage de soutien du gouvernement. Et pour cause. Les fermier·ères croulent de plus en plus sous les difficultés de toutes sortes. Les taux d’intérêts élevés, dans ce secteur fortement capitalisé où les marges sont minces, viennent augmenter significativement les paiements des entreprises, augmentant du même coup les charges d’intérêts et les défis de liquidités. La main-d’oeuvre est de plus en plus difficile à recruter, onéreuse et de moins en moins fiable. La pénurie de main-d’oeuvre est d’autant plus difficile en agriculture que beaucoup de productions sont soit très coûteuses ou impossibles à automatiser actuellement, et les emplois sont physiquement exigeants et mal rémunérés.
Faute d’être capable de mobiliser une force de travail locale, notre agriculture dépend de plus en plus des travailleur·euses étranger·ères temporaires (TET), qui sont maintenant des dizaines de milliers à prêter main forte à nos fermes chaque année. Ce recrutement engendre des coûts importants dont pour les logements ajoute une lourdeur administrative aux exploitant·es et divers autres défis dont la communication.
Le coût des intrants - carburants, fertilisants, pesticides, semences, aliments, machinerie - a explosé depuis la pandémie. La plupart des entreprises agricoles ont très peu d’emprise sur les prix qu’elles reçoivent pour leurs produits et sont à la merci des marchés internationaux ou de la bonne volonté des consommateurs. Dans un contexte de bouleversements climatiques, la météo est de plus en plus imprévisible: précipitations très abondantes, grands vents, canicules, éclosions de nouveaux ravageurs, etc. L’étalement urbain et la spéculation foncière augmentent les prix des terres agricoles. Les consommateurs et consommatrices, dans un contexte d'inflation, privilégient les aliments bon marché, laissant de côté certaines valeurs telles que le choix d'aliments locaux et/ou biologiques.
Dans ces conditions, il est évident que le secteur est de moins en moins intéressant comme choix de carrière. Peu d’enfants issus de familles agricoles sont intéressés à reprendre le flambeau d’une entreprise non rentable qui tient leurs parents occupés comme des esclaves. Certains agriculteur·trices qualifient effectivement leur condition d'esclavage. L’hyperbole exprime manifestement un sentiment d'aliénation extrême vécu par bon nombre d'entre eux et elles.
À l’encontre d’une tendance naturelle à la concentration des fermes - tendance due aux gains de productivité permis par l’innovation technologique qui entraîne des économies d’échelles - les dernières années avaient vu une certaine augmentation du nombre de fermes, propulsée par les aspirations rurales de gens en quête d’un mode de vie porteur de sens et davantage connecté à la nature, en particulier des fermes horticoles ou acéricoles de petite taille. Le rêve bucolique de plusieurs de ces aspirant·es agriculteur·trices s’est peu à peu transformé en cauchemar. Après y avoir investi leurs économies, leur entreprise rend des revenus nets faméliques, des conditions de travail inhumaines et d’autres défis difficiles à surmonter.
Tout le secteur agricole est en crise. Ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas d’un problème nouveau ou spécifiquement québécois: l’agriculture est une activité systématiquement sous-rémunérée, et ce, partout dans le monde et à toutes les époques. Les ménages agricoles dépendent pour la plupart de revenus d’emplois externes pour arriver, beaucoup de fermes arrivent à peine à faire leurs frais bon an mal an, sans pouvoir rémunérer adéquatement leurs propriétaires. De plus en plus d’entreprises n’arrivent plus à couvrir leurs frais de production. Si la donne ne change pas significativement en 2024, faillites, abandons et suicides risquent d’augmenter significativement.
Vis-à-vis notre agriculture, notre société est à la croisée des chemins. Gouvernements et consommateurs doivent faire un examen de conscience et penser au rôle qu’ils ont joué et qu’ils peuvent jouer pour la survie de notre agriculture. Pourquoi acceptons-nous, par exemple, de verser des dizaines de $ en pourboire pour un seul repas et de payer un courtier immobilier des dizaines de milliers de dollars pour accompagner une transaction immobilière, mais dès qu'il est question d'acheter des aliments de base, nous nous montrons si avares? Le cordon de la bourse se délie facilement pour nous payer des loisirs onéreux et des véhicules personnels toujours plus gros et plus luxueux, mais pas pour payer les concitoyens qui nous nourrissent. À l’autre bout du spectre, on retrouve des familles qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts ; peut-on leur en vouloir de mettre le prix comme leur premier critère d’achat? Les consommateurs manquent souvent de sensibilité aux enjeux de l’agriculture, ou n’ont pas les moyens de payer autre chose que les aliments les moins chers.
La pandémie, ayant déclenché des craintes pour la sécurité alimentaire et une vague de solidarité pour les entreprises locales, a stimulé la demande pour les produits locaux, qui s’est avérée finalement qu’un feu de paille. Les consommateurs ont vite repris leurs vieilles habitudes : s’en tenir aux produits les moins chers en supermarché, peu importe la provenance. Beaucoup d’entreprises de la chaîne agroalimentaire, distributeurs, grossistes et transformateurs, ont peu de loyauté envers leurs fournisseurs. Tout ceci met une pression à la baisse sur les prix, qui sont insuffisants pour permettre aux entreprises agricoles de faire leurs frais.
Le gouvernement subventionne et investit dans des industries comme le ciment, l’aluminium et la batterie, à coups de milliards pour attirer les emplois, souvent à des coûts par emploi créé qui frisent le ridicule, mais intervient très peu pour supporter les revenus des milliers d’agriculteurs et agricultrices. Les contraintes des ententes internationales sont un prétexte pour ne pas s’y mouiller, mais il semble probable que l’idéologie du marché y soit également pour quelque chose: on craint trop un désincitatif à l’efficacité. Force est de constater cependant que le marché et les mécanismes d’interventions actuels sont insuffisants pour permettre une rémunération décente du travail agricole.
Le système de soutien à l’agriculture, soit la recherche agronomique, le service-conseil aux entreprises et autres organismes d’intervention, est également mis à mal. Les centres de recherche sont définancés et les subventions aux services-conseils ont été récemment réduites. Conséquemment, la recherche et le transfert technologique - la diffusion de l’innovation auprès des entreprises du secteur - seront ralentis et plusieurs entreprises utilisent moins ou n’utilisent plus les services-conseils. L'expertise acquise des agronomes, notamment dans le secteur biologique, est aussi en péril si ceux-ci perdent leur emploi par manque de travail. Ainsi, les entreprises ont moins d’outils pour être performantes et moins de soutien pour se tenir à jour, de sorte qu’il sera encore plus difficile d’être rentable et concurrentiel. Les pays développés sont en constante innovation technologique pour augmenter les rendements et l’automatisation, tandis que les pays en développement se mécanisent et se modernisent. Le Québec ne doit pas perdre du terrain, le reste du monde avance.
Quel avenir pour l’agriculture dans de telles circonstances? Accepterons-nous de voir une contraction sévère de notre agriculture, un enchaînement des faillites et des abandons, un territoire agricole transformé en banlieue ou en sites de production d’énergie, et de dépendre encore plus des importations pour nous nourrir? Voulons-nous que les investisseurs étrangers et les Pangea de ce monde s’accaparent la majeure partie de nos terres pour y pratiquer une version postmoderne du système féodal où les exploitants sont des salariés sous-rémunérés? Dans un contexte de tensions internationales, de crise climatique, de déclin potentiel de la production agricole et de perte de pouvoir d’achat, le pari semble risqué et il serait prudent et stratégique de sécuriser notre agriculture en mettant tout en œuvre pour en faire un secteur solide, rentable et fiable.
Si l’on veut que notre agriculture prospère de façon durable au lieu de juste survivre, gouvernements et consommateurs doivent prendre le taureau par les cornes et mettre les bouchées doubles. Voici quelques pistes de solutions qui, selon nous, méritent d’être explorées.
Développer de nouvelles mesures de soutien aux revenus agricoles. L’agriculture est systématiquement moins rentable comme activité économique que les autres secteurs. Il serait pertinent d’intervenir dans la rémunération du travail agricole, tant celui des employés que celui des exploitants, afin de rendre l’agriculture dynamique et attrayante et d’en assurer la relève. Soit, les ententes commerciales internationales ne permettent peut-être pas de soutenir directement les revenus des entreprises. Il y a sans doute d’autres moyens qu’on peut mettre en place pour assurer que les gens qui travaillent en agriculture, qu’ils soient propriétaires d’entreprise ou à leur emploi, puissent en tirer un revenu décent. Il est toutefois crucial de garder de telles mesures découplées des superficies agricoles, afin de ne pas subventionner l’accaparement des terres, et parce que les différentes productions permettent des rendements financiers très différents par surface exploitée. Puisque c’est le travail agricole qu’il importe de soutenir, est-il envisageable d’offrir une bonification gouvernementale aux salaires agricoles? Cela permettrait d’alléger le fardeau de la main-d’oeuvre pour les entreprises, et permettrait aux propriétaires-exploitant·es, qui peuvent être des salarié·es de leur entreprise, de recevoir également une rémunération décente. Ceci pourrait être sous certaines conditions, mais il importe de développer un système léger administrativement.
Étendre le filet social aux producteurs·trices agricoles Une des injustices que subit l’entrepreneuriat agricole est que les propriétaires de ces petites entreprises n’ont pas accès au même filet social que les salarié·es. Des adaptations aux systèmes d’assurance-chômage, au régime québécois d’assurance parentale, etc., pourraient être faites afin que les propriétaires-travailleur·ses d’entreprises agricoles puissent y cotiser et en bénéficier au besoin.
Taxer les importations de produits concurrents qui ne répondent pas à des normes environnementales équivalentes aux nôtres. Il importe que l’on protège notre environnement avec une réglementation environnementale appropriée pour notre contexte. Les produits importés qui font concurrence aux nôtres ne sont généralement pas soumis aux mêmes exigences et constituent donc une concurrence à force inégale. Actuellement, nous avons le choix de pénaliser nos entreprises face à la concurrence ou de niveler nos exigences par le bas pour les arrimer aux autres. Afin de rétablir cet équilibre, nous devons explorer des avenues de clauses miroirs: à défaut de règles d’accès à nos marchés laborieuses à mettre en place, une taxation des produits étrangers permettrait de maintenir la compétitivité des produits locaux.
Compenser le coût des mesures environnementales assumés par nos entreprises qui vendent sur les marchés d’exportation. De la même manière que nos produits faits sous des exigences environnementales supérieures sont concurrencés injustement par les importations sur notre marché intérieur, ils le sont également sur les marchés extérieurs. La tarification du carbone est certes pertinente pour inciter les entreprises aux réductions des émissions de GES, mais génère un surcoût pour les exploitations agricoles. Il devrait y avoir un mécanisme qui compense les entreprises pour ce surcoût, sans affecter l’effet incitatif aux réductions des émissions.
Rémunérer les biens et services environnementaux fournis par les fermes. Nous nous attendons à ce qu’elles soient des tenancières de la terre responsables, mais nous ne leur donnons pas les conditions gagnantes pour le faire. D’abord, en leur mettant une pression constante pour être toujours plus productives et réduire les coûts au minimum. Ceci leur laisse trop peu de marge de manoeuvre pour prendre des mesures qui sont écologiquement bénéfiques, car elles coûtent du temps, de l’argent, de l’espace cultivable ou du rendement. Par ailleurs, la réglementation exige des entreprises agricoles de ne pas cultiver les bordures des cours d’eau. La mesure est pertinente pour préserver la qualité de nos cours d’eau, et une telle obligation est légitime puisque le réseau hydrographique est un bien commun. Nous devons donc, en cohésion avec cette logique, dédommager les entreprises agricoles qui renoncent à l’exploitation des bordures des cours d’eau qu’elles ont pu historiquement exploiter. Aussi, des leviers financiers et fiscaux peuvent - et devraient - être utilisés pour favoriser davantage les techniques et les systèmes de production qui pérennisent la capacité de nos sols et de notre environnement à produire de la nourriture, qui vont au-delà de la simple écoconditionnalité pour l’accès à certaines mesures de soutien, comme c’est le cas actuellement.
L’agriculture a un bon potentiel de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et à de séquestration de carbone. Toutefois, les mesures à mettre en place, que ce soit des investissements ou de l’aménagement de superficies, ont un coût qui ne devrait pas être assumé uniquement par l’entreprise. Actuellement, les programmes de rémunération des crédits de carbone sont complexes et peu payants, de sorte que rien ne se fait. Il faut simplifier ces programmes et fournir l’accompagnement nécessaire pour que les entreprises emboîtent le pas. Le programme du Québec (SPEDE) étant en place depuis 2013, aucun projet agricole de crédits de carbone n’a vu le jour, contrairement à la quasi-majorité des autres programmes de crédits de carbone, que ce soit au fédéral, en Alberta, en Colombie-Britannique, en Californie ou ailleurs dans le monde. Les seuls projets ayant vu le jour au Québec sont des projets de capture de méthane dans les lieux d’enfouissement et des projets de destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone. Pourquoi ce retard si flagrant au Québec, alors que le manque à gagner en réduction d’émission (pour atteindre -37,5% en 2030) sera comblé en achetant des crédits à l'extérieur du Québec ?
Intervenir pour limiter l’impact les taux d’intérêt élevés. Les entreprises agricoles étant très capitalisées et ayant des marges très étroites, elles sont très vulnérables aux hausses de taux d’intérêt. C’est déjà bien connu et accepté : la rentabilité limitée de l’agriculture fait en sorte que le rendement des investissements agricoles est moindre que dans le reste de l’économie. Nous ne pouvons pas raisonnablement nous attendre à ce que des entreprises qui ont une rentabilité économique de 3% fassent des emprunts à 6% d’intérêt. L’état pourrait mettre en place des mécanismes pour limiter les taux d’intérêt payés par les entreprises agricoles. Puisque l’agriculture revêt d’un enjeu de sécurité nationale et d’occupation durable du territoire, est-ce que le fond des générations pourrait être utilisé pour payer une partie de la balance des intérêts dépassant un seuil maximal imposé? Peut-on imposer au secteur financier d’accorder des taux d’intérêt préférentiels au secteur agricole? Est-ce que les investissements agricoles pourraient être financés par une institution paragouvernementale telle que la Caisse de dépôt et de placement? Est-ce qu’une remise gouvernementale pourrait compenser les paiements d’intérêts des entreprises agricoles, sous forme de crédits d’impôt par exemple, avec quelques paramètres d’écoconditionnalité?
Rendre les assurances accessibles. L’accessibilité des assurances est également un enjeu de plus en plus criant. De plus en plus de fermes sont incapables d’obtenir les assurances nécessaires pour leurs opérations, les compagnies privées refusant de les assurer. Dans une optique où la sécurité de notre agriculture est d’une importance capitale pour la société, est-il possible de mettre en place un système public d’assurance agricole - au-delà des régimes d’assurance récolte déjà en place - qui aurait l’obligation d’offrir une couverture complète à toute entreprise agricole qui en fait la demande? Par ailleurs, le régime actuel d’assurance récolte, qui est important pour bon nombre de cultures, laisse pour compte beaucoup de secteurs de productions émergents. Les secteurs émergents ont d’autant plus besoin d’un filet de sécurité que la maîtrise technique des productions est moins aboutie, la demande moins soutenue et les entreprises, jeunes et plus vulnérables. L’assurance-récolte doit être adaptée aux productions émergentes et aux nouveaux systèmes de production.
Investir massivement dans des campagnes d’éducation et de sensibilisation à la réalité agricole. Divers axes devraient être utilisés pour que les consommateurs et consommatrices:
Réduire le fardeau administratif des entreprises agricoles et des organismes d’intervention en agriculture. Afin de les soulager du stress et du temps de travail qui doit être consacré à la paperasse.
Investir davantage dans les centres de recherche agricoles, incluant les centres indépendants. Les chercheurs doivent pouvoir se consacrer à la recherche et au soutien au secteur, et moins être toujours en recherche de financement et en reddition de comptes.
Mobiliser tous les mécanismes à la disposition de l’état pour lutter contre la spéculation foncière qui met une pression prohibitive sur les prix des terres agricoles, et en inventer de nouveaux. Investir dans des projets porteurs comme les fiducies d’utilité sociale en agriculture et le Chantier d’accès à la terre. Les municipalités pourraient, comme c’est fait en France, utiliser leur droit de préemption pour éviter la vente de terres agricoles à des promoteurs immobiliers.
Bonifier la SNAAQ (Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois) pour favoriser de plus gros volumes d’achat. Donner plus de marge de manoeuvre aux gestionnaires des institutions pour s’approvisionner davantage de façon autonome sans passer par les regroupements d’achats et sans avoir comme seul critère le prix des produits. Idéalement, favoriser l’achat de produits biologiques - qui pourrait même faire l’objet d’une contribution gouvernementale - afin d’améliorer la performance environnementale de notre agriculture.
Assouplir l’encadrement des travailleurs étrangers temporaires (TET). Les TET font partie de la réalité agricole du Québec et ils représentent une main d’œuvre fiable, efficace et rentable pour les entreprises. Toutefois, la lourdeur administrative actuelle, les délais de traitement des demandes et les frais exorbitants pour avoir recours à cette main d’œuvre fait en sorte que ce n’est pas accessible pour plusieurs entreprises. Il serait bénéfique que les TET puissent transférer de fermes plus facilement pour de courtes périodes, sans qu’il y ait autant de frais encourus. Il serait avantageux qu’un TET puisse travailler sur deux entreprises en même temps, pour les petites entreprises qui ne peuvent pas en engager à elles seules. L’immigration des TET pourrait aussi régler une partie des problèmes de main d’œuvre sur les entreprises agricoles, rendant cette force de travail plus accessible, moins coûteuse et plus fiable. Nos critères actuels d’immigration font en sorte qu’il est pratiquement impossible pour les TET d’immigrer ici, essentiellement parce qu’ils n’ont pas de diplôme et qu’ils ne parlent pas français. Or, l’agriculture a besoin d’ouvriers formés et non d’employés avec des diplômes universitaires, et les TET répondent bien aux besoins actuels. Il serait possible de prévoir leur francisation sur les entreprises agricoles, et les paramètres d’immigration pourraient être ajustés, si ce n’est pas dans l’ensemble, avec des exceptions pour les travailleurs agricoles.
Les changements à faire exigent de l’audace et de la créativité.
Geoffroy Ménard
Agroéconomiste, Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
Mathieu Dumas
Consultant en changements climatiques et producteur maraîcher biologique
Denis La France
Enseignant, Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
Judith Colombo
Agronome, Collectif Récolte
Emilie Turcotte-Côté
Propriétaire de Les jardins d’etc, B.Sc. agronomie
Catherine Théberge
Chercheuse, Centre d’innovation sociale en agriculture
Ianik Marcil
Économiste
Caroline Laurin
B.Sc. (Ag.Env.Sc), productrice maraîchère biologique
6 juin 2024
Commentaires